Communiqué du réseau "Sortir du Nucléaire"
Le 19 décembre 2012, l’ASN a donné son accord à la réalisation des travaux pour le renforcement du radier du réacteur 1 de la centrale de Fessenheim. Le Réseau "Sortir du nucléaire", Alsace Nature, le Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, Stop Fessenheim et Stop Transports - Halte au Nucléaire ont déposé un référé pour empêcher la réalisation de ces travaux inutiles et coûteux.
Une prolongation d’exploitation conditionnée à la réalisation de travaux colossaux
À l’issue de la troisième visite décennale du réacteur 1 de Fessenheim, l’ASN a rendu un avis favorable  à la poursuite de son exploitation après 30 ans de fonctionnement, sous réserve de respecter différentes prescriptions [1]. Il s’agit notamment de renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013. Le 19 décembre 2012, elle a donné son accord pour qu’EDF procède à la mise en œuvre de la modification proposée, consistant à augmenter à la fois l’épaisseur et la surface de la zone d’étalement du corium en cas d’accident grave avec percement de la cuve.
à la poursuite de son exploitation après 30 ans de fonctionnement, sous réserve de respecter différentes prescriptions [1]. Il s’agit notamment de renforcer le radier du réacteur avant le 30 juin 2013. Le 19 décembre 2012, elle a donné son accord pour qu’EDF procède à la mise en œuvre de la modification proposée, consistant à augmenter à la fois l’épaisseur et la surface de la zone d’étalement du corium en cas d’accident grave avec percement de la cuve.
Colossaux, les travaux prescrits n’ont pas de précédent : il s’agit notamment de couler environ 50 cm d’un béton spécial dans le puits de cuve [2] et dans une zone voisine réaffectée en « local de collecte ». De plus, pour permettre l’étalement du corium entre ces deux zones, il faudra creuser un canal de transfert.
Au vu de l’ampleur de cette modification, celle-ci devrait faire l’objet de la procédure d’autorisation telle que prévue par l’article L 593‐14 du Code de l’environnement, qui impose notamment une enquête publique en cas de modification notable d’une installation nucléaire.
Des travaux coûteux, inutiles, voire dangereux pour une centrale destinée à une fermeture imminente
Alors que les économies d’énergie et les énergies renouvelables manquent cruellement de soutien, il est inacceptable de gaspiller des dizaines de millions d’euros dans de tels travaux. La centrale de Fessenheim est dangereuse et devrait être arrêtée maintenant [3]. Alors même que le gouvernement s’est engagé à la fermer durant le quinquennat, autoriser ces travaux revient à donner un argument à EDF, qui ne manquera pas d’invoquer leur rentabilisation pour justifier la poursuite de l’exploitation du réacteur.
Les travaux se dérouleront dans un environnement extrêmement radioactif, juste sous la cuve du réacteur. En dépit des déclarations d’EDF, qui peut garantir que les personnes qui seront chargées des opérations ne courront aucun risque ? Il serait inacceptable que des travailleurs soient exposés à des radiations intenses pour ce chantier qui n’est même pas destiné à prévenir le risque d’accident. En effet, l’objectif est uniquement, une fois l’accident arrivé, de reporter d’une journée environ (soit 44 h après au lieu de 24) le moment où le combustible en fusion percera le socle de béton du réacteur et entrera en contact avec la plus grande nappe phréatique d’Europe !
Ces travaux ne changeront rien aux risques qui pourraient mener à un accident à Fessenheim : vieillissement, situation en zone sismique, près d’un aéroport, en contrebas du grand canal d’Alsace…
La seule manière d’assurer la sécurité est de fermer cette centrale. Ces travaux aussi coûteux qu’inutiles sont un leurre. Le 21 mars 2013, le Réseau "Sortir du nucléaire", Alsace Nature, Stop Transports - Halte au nucléaire, Stop Fessenheim et le Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin ont déposé un référé devant le Conseil d’État afin de les empêcher.
Notes
[1] Décision de l’ASN n° 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011
[2] Zone hautement radioactive située juste sous le réacteur
[3] Selon un rapport commandé par le ministère de l’Environnement du Bade-Wurtemberg, Fessenheim aurait déjà dû être fermée si on lui avait appliqué les critères de sûreté en vigueur en Allemagne : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Analyse-de-l-Oko-Institut






 Pour ceux qui ne lisent pas couramment le Flamand, voici la traduction française des ses propos, prononcés lors d'une interview sur une radio belge. W De Roovere doit quitter prochainement son poste, ce qui lui donne une grande liberté de parole.
Pour ceux qui ne lisent pas couramment le Flamand, voici la traduction française des ses propos, prononcés lors d'une interview sur une radio belge. W De Roovere doit quitter prochainement son poste, ce qui lui donne une grande liberté de parole. opérationnelle et que"des efforts importants devront être faits pour qu’outre le matériel, l’ensemble de la documentation nécessaire à l’utilisation de ce système soit en place à la fin de l’année". Il restera combien de temps pour que le personnel soit formé et entraîné à l'utilisation de cet équipement ?
opérationnelle et que"des efforts importants devront être faits pour qu’outre le matériel, l’ensemble de la documentation nécessaire à l’utilisation de ce système soit en place à la fin de l’année". Il restera combien de temps pour que le personnel soit formé et entraîné à l'utilisation de cet équipement ?
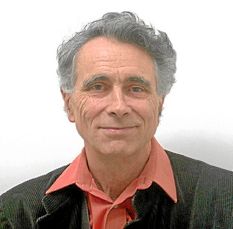 l’énergie et de maîtrise de l’énergie, membre de l’association Global Chance.
l’énergie et de maîtrise de l’énergie, membre de l’association Global Chance.